Fondateur et ex-rédacteur en chef d'Arty Magazine, le grand manitou…
Recueil de nouvelles autobiographiques, Je n’aime que la musique triste aligne en 118 pages les souvenirs, réflexions et disgressions du journaliste Adrien Durand, ancien fer de lance du tout-Paris et repenti de l’industrie musicale.
Vingt minutes, c’est la durée moyenne que passe un francilien dans le métro. C’est aussi le temps que tu prendras pour lire cette interview – on a connu format plus court, retraçant l’expérience passionnante du journaliste Adrien Durand. Si ton trajet sur une ligne 13 bondée se termine avec le sourire aux lèvres, le voyage peut reprendre le lendemain matin avec Je n’aime que la musique triste, recueil d’histoires acides et désopilantes sur l’industrie de la musique, dont la lecture d’une nouvelle peut tenir dans le même espace-temps.
Organisateur de concert, attaché de presse, musicien et journaliste, Adrien Durand se définit comme un activiste de la scène indépendante. Le genre de personnages qui te déballe une collection d’anecdotes aux titres aussi alléchants que : Morrissey n’a pas trouvé l’amour, Les chiottes de bar me manquent, Parfois, il faut laisser le cerveau au vestiaire. Pourfendant les travers de l’industrie et ses mondanités avec une hauteur de vue jouissive, Adrien nous reconnecte à la communion originelle de Patti Smith, Gil Scott Heron, Cindy Lauper, Serge Gainsbourg ou encore Alpha Wann. Preuve qu’à 38 ans, on peut viser à la fois l’utopie et le bonheur.

Marin : Salut Adrien. Commençons par le commencement avec ton fanzine le Gospel. En quoi cela consiste ?
Adrien Durand : J’avais bien envie de sortir de la dictature de l’actualité avec un projet papier. Avant je bossais pour un média en ligne (ndlr : The Drone) où on avait un lectorat très large mais pas forcément très concerné, avec beaucoup de gens qui commentaient les articles sans les avoir lus, des travers dont j’avais un peu marre. Je trouvais que ça manquait de sens quand on parlait de musique de niche. J’ai redémarré en me disant que je voulais me détacher de l’actu pour parler de la musique sous un angle socio-culturel, historique et personnel.
M. : C’est ton espace de liberté ?
A.D. : Oui totalement, parce que j’ai toujours écrit pour d’autres médias. Au même moment où j’ai commencé Le Gospel, on m’a proposé d’écrire pour Les Inrocks, avant ça j’ai écrit pendant 5 ans pour les pages musique de Vice. Je devais entrer dans leur ligne, écrire d’une certaine façon, sur un certain type de groupes. Je voulais m’en affranchir et retrouver un contact direct avec les gens. J’ai quitté Paris pour m’installer à Bordeaux, je sentais que j’étais arrivé à la fin d’un cycle et Le Gospel était une manière d’en commencer un nouveau, basé sur le parcours que j’avais eu en tant qu’organisateur de concert, de journaliste, d’attaché de presse… Ce que l’on appelle un activiste de la scène indépendante (rires).
M. : L’un des derniers numéros du Gospel portait sur « Une autre histoire du DIY », un sujet régulièrement récupéré par les sphères mainstream. C’est un sujet qui t’importe ?
A.D. : C’est cette idée de donner une autre lecture des choses, c’est vrai que le do it yourself a été récupéré par les majors, les gros artistes, les marques… C’était une interrogation sur comment le do it yourself a pu être investi par le grand capital, alors que c’était à l’origine une solution alternative. Ce n’était pas du tout dans l’optique de dire que c’était mieux avant, mais plutôt d’interroger notre part de responsabilité sur ce que c’est devenu. Le do it yourself est très précieux en permettant de faire les choses par ses propres moyens. Ce numéro est un pas de côté pour proposer une réflexion un peu plus poussée qu’un papier de 5 000 signes sur un média généraliste.

M. : Pour parler de ton livre Je n’aime que la musique triste, tu écris dans l’avant-propos qu’écrire sur ton attachement pour la musique triste t’est venu en décembre 2020. Pourquoi cette temporalité ?
A.D. : Déjà parce que j’avais du temps. Aussi parce que depuis 2/3 ans, j’ai mis un coup d’accélérateur sur mon activité d’écriture. J’ai l’impression que ça plaît aux gens, je suis beaucoup porté par les messages positifs que je reçois. J’avais envie de faire un récit de manière très spontanée. Je trouvais ça chouette de prendre le temps de m’arrêter pour regarder tout ce qui s’était passé avant. D’ailleurs les textes sont publiés dans l’ordre dans lesquels je les ai écrits.
M. : Qu’est-ce que recouvre le terme de « musique triste » ?
A.D. : L’idée c’est de partir de mon cas très personnel, où les gens peuvent prendre des choses et se reconnaître. C’est pour ça que je voulais qu’il y ait à la fois un titre à la première personne et quelque chose d’assez large pour que les lecteurs se sentent inclus. Je me suis dit que c’était le bon moment d’analyser notre relation à la musique, dans un contexte où on la vit de manière très distanciée, sans les moments de communion. J’aime bien le terme de « lien animal » parce qu’il y a cette chose là dans la musique, qui génère une émotion chez nous, on ne sait pas trop pourquoi. Pourquoi les gens vont avoir cette forme d’euphorie quand un DJ va passer un morceau super triste dans un festival gigantesque ? Et pourquoi des fois, tu es bourré tout seul dans la rue, tu écoutes Cindy Lauper et tu as l’impression de vivre un moment super important dans ta vie ?
M. : Tes nouvelles sont portées par une analyse mordante, voire absurde. Il y a un récit que j’aime beaucoup, Les Chiottes de bar me manquent, où tu parles de ce liant animal dans un moment plutôt inattendu ?
A.D. : Cette tradition du bar pourrave est quelque chose que j’aime beaucoup à Paris. Tu te retrouves avec les gens qui vivent dans le quartier, comme à Grands Boulevards ou à Pigalle, et des touristes en goguette qui n’attendent que de discuter aux chiottes avec de vrais parisiens. J’aime bien cette ambiance parce qu’il suffit qu’il y ait un morceau d’ABBA ou de Johnny et tout le monde se retrouve à beugler ensemble. Il y avait ce bar que j’aimais bien à Bastille, Le Saint Nicolas, où j’emmenais les groupes quand j’organisais des concerts. Les américains étaient trop contents d’être avec les poivrots et les étudiants du quartier.
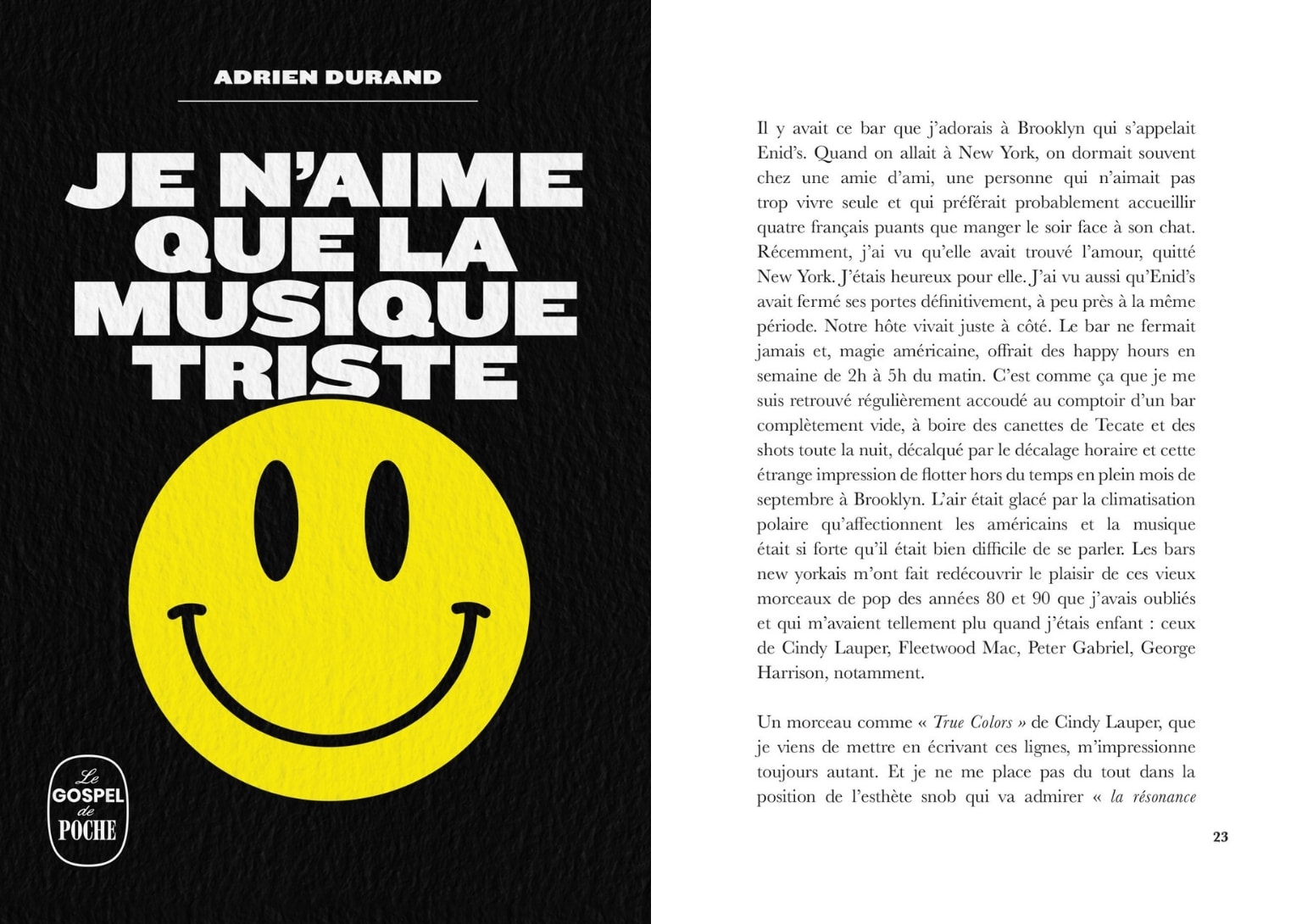
M. : Tu portes ces expériences par un style très incarné. Ça me fait penser au journalisme gonzo de Hunter S. Thompson ou à certaines introspections désabusées de Woody Allen. Quels modèles portent ton écriture ?
A.D. : Je ne connais pas trop Hunter S. Thompson, je m’en suis toujours tenu à distance. Je n’apprécie pas forcément l’approche très masculiniste des gens de ma génération qui l’ont porté. Par contre, il y a un livre du journaliste américain David Carr que j’aime beaucoup : La Nuit Du Revolver. Ça part d’une brouille avec son ami, il ne sait plus pourquoi, et le mec lui dit : « Moi je sais pourquoi, t’as pointé un revolver sur moi. » Il a 50 ans et il part faire une enquête sur les années où il prenait du crack et de la coke, il ne se souvient de rien. Ça se passe à Minneapolis. J’aime bien ce genre de journalisme à la lisière de l’autofiction. Il y a un autre écrivain que j’aime beaucoup, Tony O’Neill, qui est l’ancien clavier de The Brian Jonestown Massacre. Il a écrit des romans dans cette veine entre la musique et le récit miroir.
M. : Tes textes portent autant sur Patti Smith que Morrissey, comment ont-ils surgi ?
A.D. : Par association d’idées, essentiellement. Je les ai arrangés comme j’aurais fait une mixtape avec des morceaux qui cliquent instantanément dans la tête des gens. Par exemple, quand je passe Babooshka de Kate Bush en DJ Set, il y a deux trois personnes qui viennent me voir systématiquement pour me dire qu’ils adorent le titre, alors que ce n’est pas le plus évident de la Terre.
M. : Quand tu me parles de « cliquer », je pense à ta phrase : « Vouloir sortir du superficiel pour toucher le réel. » Le clic, c’est aussi cette recherche du réel ?
A.D. : C’est aussi pas mal lié au fait que j’ai été un membre éminent de ce que l’on appelle l’industrie musicale, et ce n’est pas forcément quelque chose que j’ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de gens qui n’aiment pas vraiment la musique et ce sont souvent ceux qui ont le pouvoir. Ceux qui ont un amour pur de la musique se retrouvent en position de paria. Ce sont des situations que j’ai trouvé parfois un peu violentes. Je préfère sortir de l’industrie musicale et toujours aimer la musique, que faire comme beaucoup de mes congénères en ayant les dents qui rayent le parquet.
M. : C’est la vision business que tu débectes ?
A.D. : Je ne sais pas si je la débecte, je gagne toujours ma vie en partie en bossant avec des labels et des festivals. Mais l’organisation industrielle de la musique, je trouve qu’elle va un peu à l’encontre de valeurs qui nous font y adhérer, tout ce à quoi on croit dans le milieu associatif, DIY ou punk. Cas typique, beaucoup d’artistes me disaient que les médias comme la télé c’était nul. Et puis d’un seul coup, Le Grand Journal les appelait, et il n’y avait plus de problèmes pour raboter leurs morceaux de cinq minutes et faire les clowns au milieu des invités. La musique est un peu victime de ça. C’est sûrement très simpliste comme vision mais je préfère me tenir à celle-là.
M. : Tu portes aussi un regard tordant sur les mondanités, comme cette soirée organisée dans le « Airbnb de Kanye West »…
A.D. : Ouais (rires). Il y a l’idée de regarder les choses en face et de me dire, que moi aussi à une époque, j’ai trouvé ça cool d’avoir un pass VIP, que l’on me paie des coups, de traîner avec des musiciens que j’aime bien, de partir en festival à Austin… Pour un peu spoiler, aux 2/3 du livre il y a une cassure où je me rends compte que je suis devenu le même trou du cul que les autres. C’est là où j’ai un choix à faire : soit je continue ma carrière de trou du cul, soit je fais un pas en arrière.
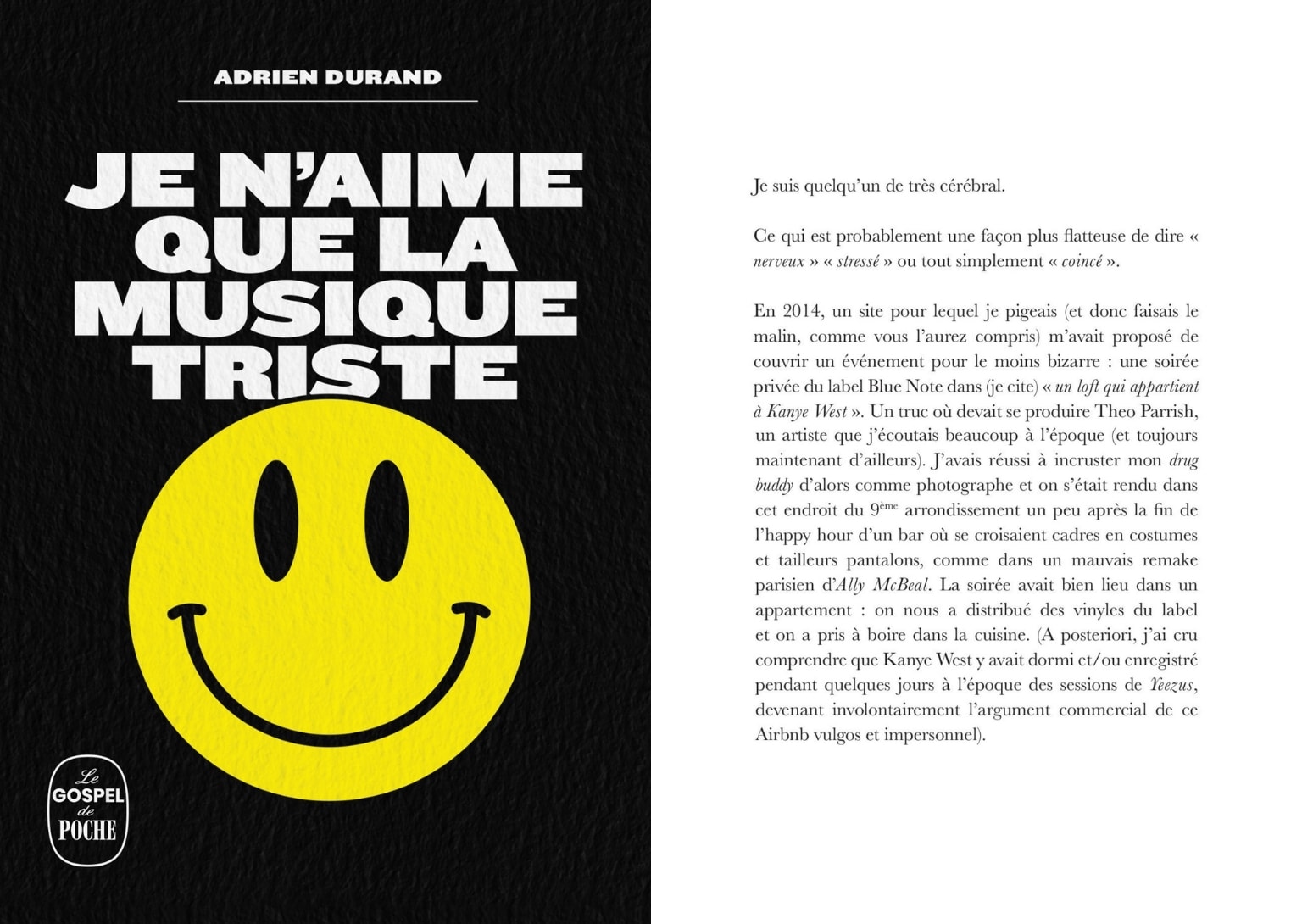
M. : Le rappel de ces événements alimente une forme de mélancolie chez toi ?
A.D. : Ce qui était super important pour moi, c’est que le livre ne soit pas triste. Je voulais que ce soit drôle, émouvant, que les gens se reconnaissent dans les situations. Je n’ai pas vécu une enfance extraordinaire de star dans les années 70 à Hollywood. J’ai eu le parcours classique du jeune mec de province qui va faire ses études à Paris et qui bosse pendant 20 ans dans la musique. L’idée, c’est que le sentiment mélancolique que je pouvais retrouver dans plein de choses que j’aimais, agisse comme un marqueur temporel. Quand les gens disent : « Ah ce morceau, je l’aime bien », ça leur met un petit post-it dans la tête et ils ont l’impression de vivre un moment important. La mémoire est une reconstruction permanente, c’est-à-dire qu’à chaque fois que tu racontes une histoire il y a des éléments en commun et d’autres différents. On vit tous dans notre propre fiction, que l’on aménage comme on veut.
M. : C’est comme le coup du revolver à Minneapolis dans La Nuit Du Revolver ?
A.D. : Oui exactement (rires). C’est la Madeleine de Proust, cette histoire de revenir à quelque chose d’originel, finalement très lié au comportement addictif. Se dire que la première fois que je suis allé à un concert, le premier pogo où je me suis retrouvé, la première guitare branchée sur scène, ça m’a fait ce sentiment. J’aimerais le retrouver mais c’est impossible.
M. : Je trouve l’esprit rock très présent dans ton recueil, comme le cri de Courtney Love que tu décris. Cet esprit rock a guidé ton écriture ?
A.D. : Je pense que c’est une totalité. J’ai 38 ans, ça fait presque 30 ans que j’écoute de la musique, 20 ans que j’écris, autant que je joue dans des groupes. C’est une part importante de ma vie. Maintenant, c’est en moi. Après je n’aime pas l’érudition associée au rock’n’roll, ce côté esthète et dandy. C’est de la pose. Il y a des morceaux de Christine and the Queens que j’aime sincèrement sans que ce soit de la pose, et en même temps je suis très touché par tout le punk-rock des années 80. Je voulais juste faire un livre honnête. Ce que je retiens de l’éthique punk, c’est de ne pas faire semblant.
M. : Et ton expérience de la scène ?
A.D. : Ça été une part importante de ma vie pendant 6/7 ans. Mon activité de musicien s’est clairement arrêtée quand la dimension d’industrie a pris le pas sur le reste. En vieillissant, tu dois faire des choix, tu commences à avoir une vie de famille. Je faisais des concerts dans des groupes de musique assez violente, où les gens pogotaient de partout, avec certains excès liés à la tournée. Un moment, tu es allé au bout de cette voie. Ça fonctionne parce que c’est fugace.
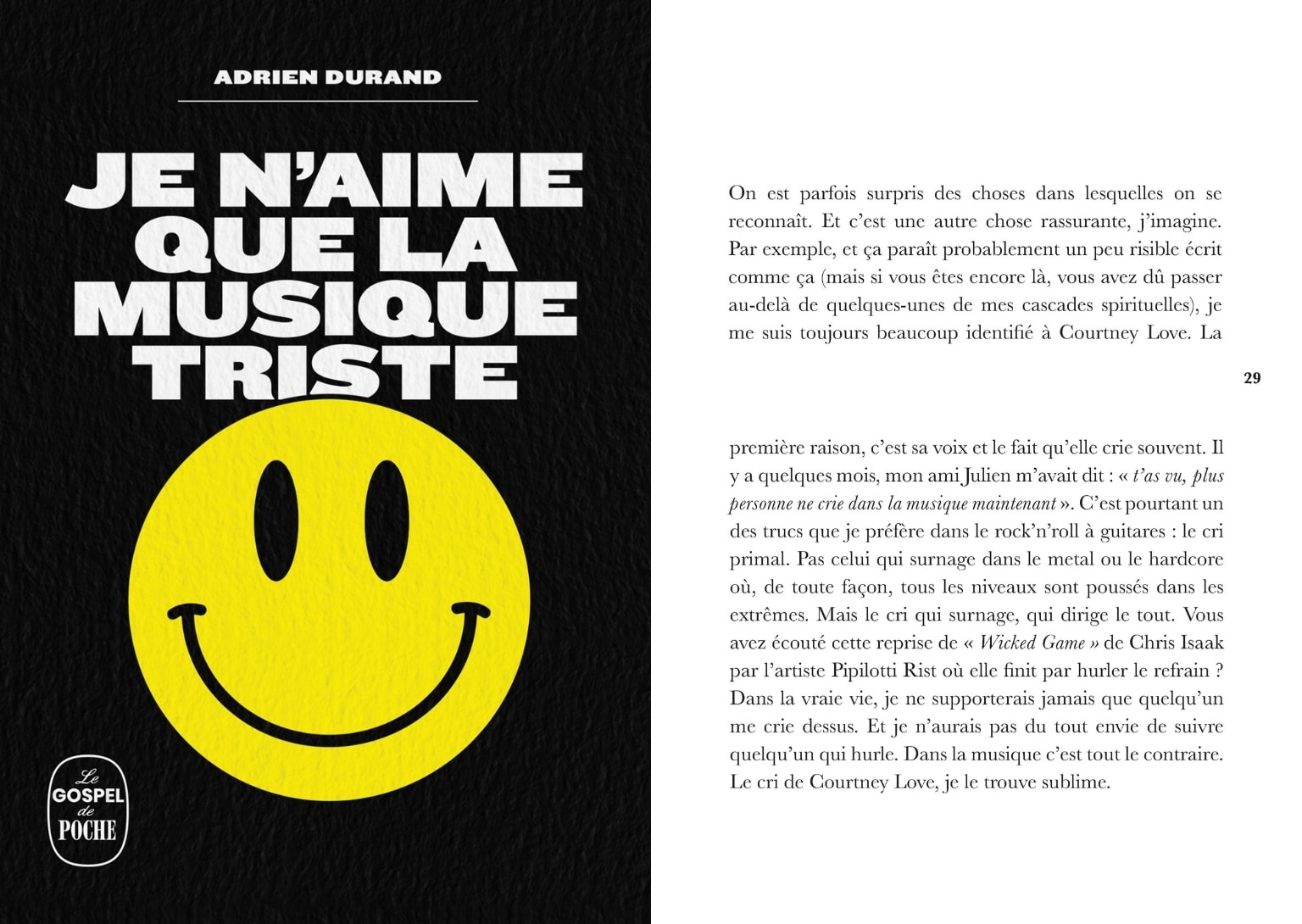
M. : Ça résonne avec ton avant-propos : « Ne me jugez pas, j’avais 14 ans, j’écoutais du grunge, j’aimais Rimbaud, Araki et Larry Clark comme tous les gamins de ma génération. » Est-ce que le gosse de 14 ans est la même version en plus idéaliste de toi adulte ?
A.D. : Il y a une version passée et une évolution logique. Quand j’avais 14 ans, j’imaginais être une version assez proche de ce que je suis maintenant, peut-être avec un parcours moins chaotique. Globalement, j’ai l’impression d’être en accord avec moi-même.
M. : Tu cites 3 piliers : Rimbaud, Araki et Larry Clark. Ces maîtres à penser seraient remplacés par d’autres aujourd’hui ?
A.D. : C’est davantage une histoire d’étapes. Il y a des moments où entrer dans l’œuvre d’un romancier, d’un cinéaste, d’un photographe ou d’un musicien, ça t’ouvre des portes vers plein de nouvelles choses. Aujourd’hui encore, je découvre des œuvres qui m’emmènent vers d’autres. J’aurais sûrement d’autres références maintenant. C’est difficile de trouver des artistes qui produisent une œuvre qui t’intéresse sur la longueur.
M. : Quels sont maintenant tes films ou tes livres de chevet ?
A.D. : Retour vers le futur (rires). C’est un film qui me passionne vraiment. D’ailleurs, l’écrivain new-yorkais Ben Lerner a écrit 10:04 où le film est une trame dans son roman. Sinon, toujours en livre, Freedom de Jonathan Franzen qui raconte l’histoire d’un triangle amoureux sur fond de musique. En film, j’ai revu Shadows de John Cassavetes, c’est toujours très beau ces films tournés avec des post-adolescents. En musique, je reviendrais toujours à Nirvana. C’est un groupe que j’écouterais toujours et qui m’a permis de découvrir plein de choses avant Internet.
M. : C’est marrant parce que Nirvana est devenu l’icône moderne du spleen. Tu penses que la musique triste est vouée à se populariser ?
A.D. : On est dans une époque où la tristesse est devenue la norme. J’écrivais un article ce matin sur un disque jugé super sombre à l’époque, alors que aujourd’hui tu écoutes Billie Eilish, Future ou PNL. Ce qui doit rester important, c’est qu’il y ait des formes musicales sincères, dans l’underground comme dans la musique populaire, que ce soit Lana Del Rey ou dans le black metal norvégien. C’est une bonne chose pour conjurer ses angoisses. D’ailleurs, écrire ce livre, ça m’a permis de me reconnecter à des souvenirs que j’ai pris plaisir à revisiter et sans doute exorciser, tout en me disant qu’une nouvelle étape s’ouvrait.
M. : À quand le tome 2 ?
A.D. : J’y pense. J’ai plein de matériau qui n’entrait pas dans le premier. Si ça vient, ce serait vraiment avec plaisir. Je crois que je préfère écrire à jouer de la musique, ça m’est devenu essentiel.
M. : Davantage que boire des coups à Bastille avec un groupe américain ?
A.D. : Faire la fête, ça me manque un peu (rires). Mais c’est voyager qui me manque encore plus, c’était ma principale source de dépenses avec acheter des livres et des disques. Je me sens un peu comme un lion en cage.
M. : On arrive à ma dernière question, la tradition chez Arty Magazine. Quelle est ta définition d’un artiste ?
A.D. : C’est quelqu’un qui lutte contre la peur de mourir.
M. : Et ça marche ou pas ?
A.D. : Je crois que ça marche pas mal (rires).



















